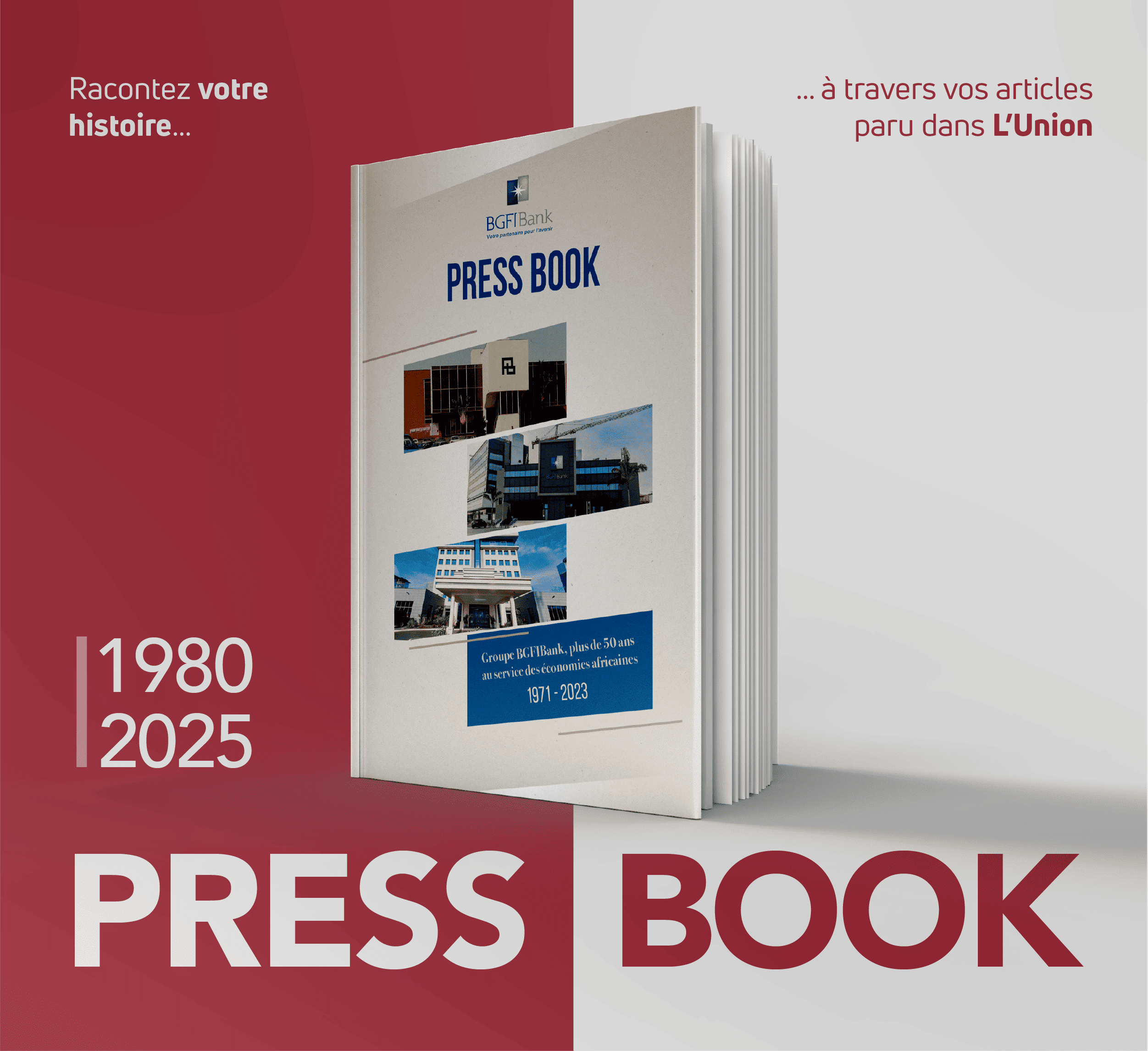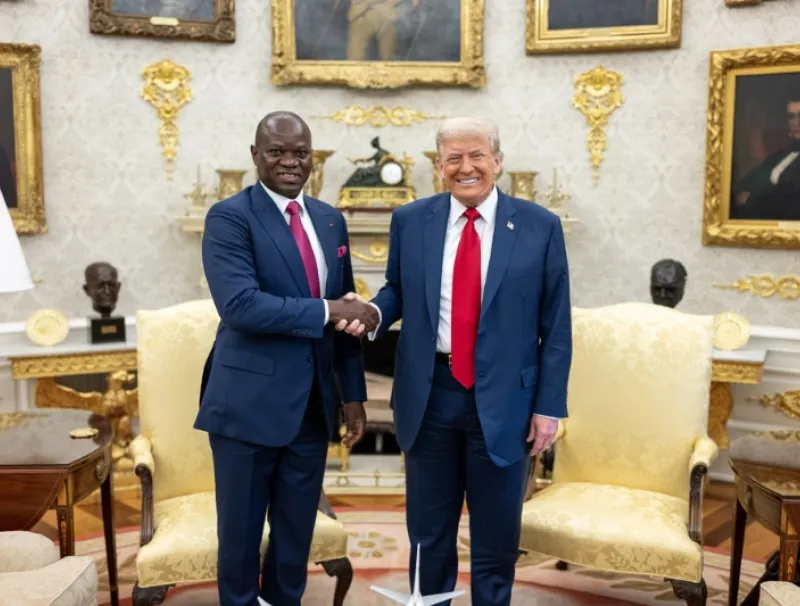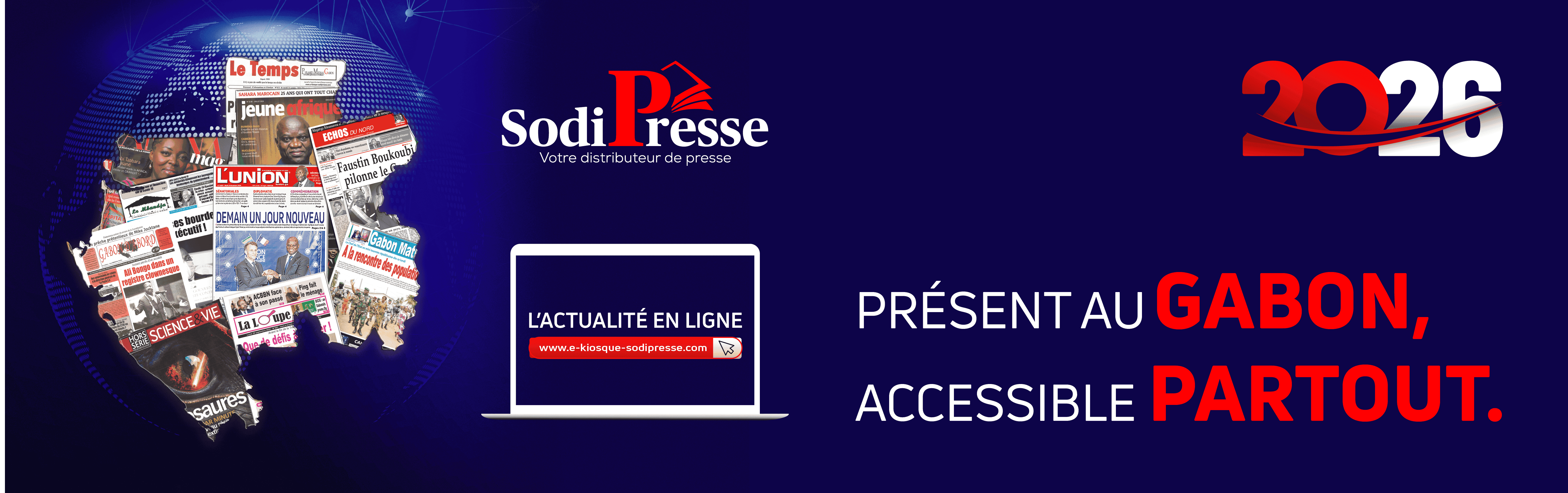Annoncées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, non moins chef du gouvernement, Régis Onanga Ndiaye (Affaires étrangères) et Hermann Immongault (Intérieur) ont enfin donné, hier, des explications poussées sur le verdict rendu le 19 mai dernier par la Cour internationale de justice (CIJ). C'était au cours d'une interpellation du Sénat de la Transition. Un "grand oral" auquel ont assisté le vice-président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier et les deux ministres d'État de la première équipe gouvernementale de la Ve République.
Après l'appel nominatif, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, a rappelé les dispositions de l'article 42 du Règlement intérieur autorisant l'interpellation des membres du gouvernement à la faveur des séances plénières retransmises en direct. Premier de cordée, Régis Onanga Ndiaye a, d'entrée, souligné que le sujet débattu touche à la souveraineté nationale. Non sans déplorer les conclusions et autres analyses hâtives devenues virales sur la toile et distillées par certains médias.
Par la suite, il a dressé l'historique dudit conflit. Lequel, selon lui, remonte à la période coloniale, à l'époque entre la France et l'Espagne. D'où la convention franco-espagnole de 1900 sur laquelle la CIJ s'est appuyée pour trancher le différend. "(...) Au milieu de l'année 1974, le réchauffement des relations entre les deux pays, marqué par des visites respectives des chefs de l'État de l'époque et la signature de la Convention de Bata", a-t-il laissé entendre. Laquelle convention constitue la pomme de discorde. Vu que les autorités de Malabo la balaient d'un revers de la main.
Après trois médiations infructueuses, la Guinée équatoriale a porté l'affaire devant la justice. "L'option de saisir la CIJ est du fait de la Guinée équatoriale", a indiqué Onanga Ndiaye. Avant de préciser : "La Cour était chargée de délibérer sur les traités et autres documents présentés par les deux parties".
"Dura lex sed lex (la loi est dure mais c'est la loi), les juges de La Haye se sont basés sur la convention franco-espagnole", a-t-il indiqué. Avant de déclarer : "Les deux États sont condamnés à vivre ensemble, au regard des facteurs géographiques, linguistiques, culturels". Pour lui, le rendu de la Cour a amplifié la "complexité du différend" et renvoie les deux parties "au dialogue". "Nos deux pays doivent très vite se retrouver pour discuter (...) il n'y a pas d'autre choix que la négociation", assure-t-il.
Son collègue de l'Intérieur a, quant à lui, exposé sur les différentes frontières du Gabon avec trois pays frontaliers (Congo, Cameroun et Guinée équatoriale). Dans la foulée, il a fait part des problèmes sécuritaires enregistrés aux différentes frontières. Occasion pour lui de formuler un plaidoyer inhérent à l'occupation des frontières.
Suite aux deux exposés dix-sept (17) sénateurs ont pris la parole, qui pour des propositions, qui pour des questions. Reprenant la parole, les ministres interpellés ont apporté les précisions. Et réaffirmé que la négociation constitue la prochaine étape. Car il y va de la souveraineté nationale. D'autant que contrairement à ce qui est ventilé çà et là, le Gabon n'est pas en position de faiblesse.
"Il n’y a pas péril en la demeure. À ce jour, il n’y a pas d'études démontrant de fortes potentialités pétrolières sur l'île Mbanié", affirme Régis Onanga Ndiaye. Toujours au titre des conséquences : "Si on s'en tient à la Convention franco-espagnole de 1900, 80 % d'Ebibiyin serait sur le territoire gabonais", clame Hermann Immongault. C'est dire l'importance de la négociation souhaitée !
random pub