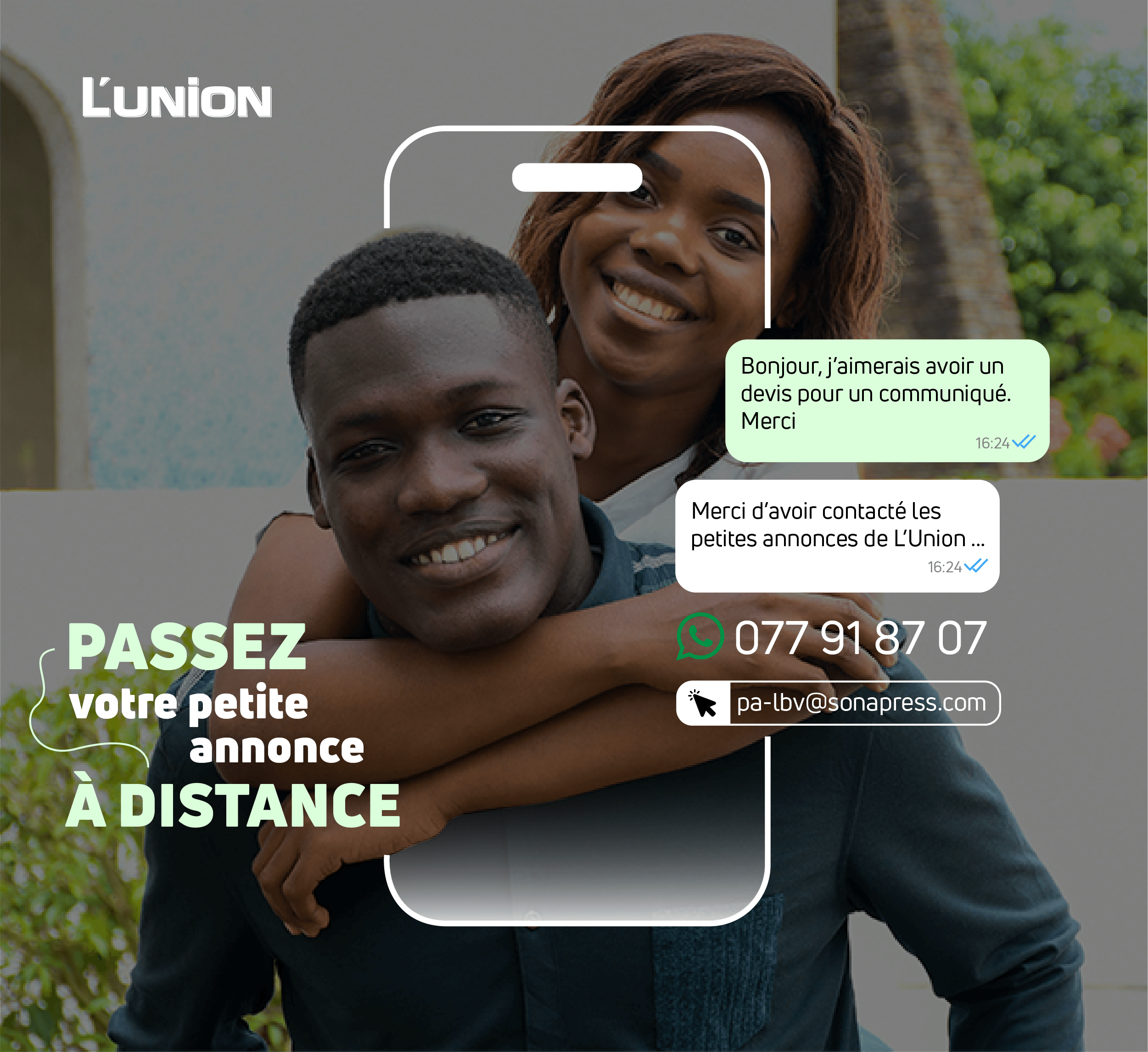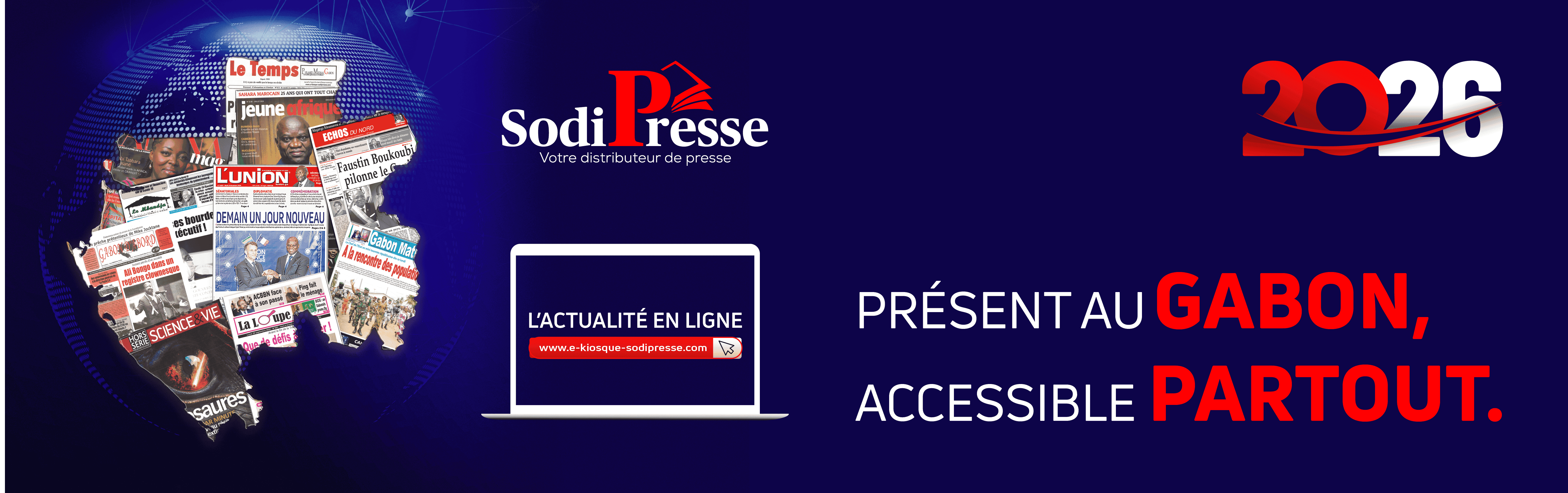Par Christophe NZE MBA - Cadre supérieur du secteur privé, ancien conseiller du maire de Libreville, fils de l’Estuaire
--
Dans un contexte africain postcolonial encore marqué par la résilience des appartenances communautaires et la centralité des identités territoriales dans la structuration des pouvoirs locaux, la question de la gouvernance municipale soulève des interrogations cruciales.Le cas de la Mairie de Libreville, capitale du Gabon, constitue un prisme révélateur des tensions entre logique institutionnelle, équilibre identitaire et cohésion nationale.
En effet, bien qu’aucune norme juridique ne l’exige, une tradition politique s’est progressivement installée, selon laquelle le poste de maire de Libreville reviendrait préférentiellement à un ressortissant de la province de l’Estuaire, plus précisément à un Mpongwe ou à un Fang issu de cette province. Cette pratique non écrite, parfois qualifiée de "loi tacite", suscite à la fois approbation prudente et contestation vive.
Derrière cette coutume politique se dessine en réalité une logique d’équilibre ethno-territorial, fondée sur la recherche de stabilité sociopolitique dans un espace urbain hyperconcentré, où coexistent des communautés venues de toutes les provinces du pays. Il ne s’agit donc pas d’un simple privilège ethnique, mais d’un pacte non formulé permettant d’assurer une représentativité sensible à l’histoire, aux dynamiques démographiques, et aux équilibres fragiles de la capitale gabonaise. Dès lors, cette approche invite à une analyse dépassionnée et académique des formes de gouvernance locales qui, tout en restant inclusives, reconnaissent les réalités sociales et politiques du terrain.
Eu égard à ce qui précède, nous pouvons nous demander dans quelle mesure la préservation d’un équilibre ethno-territorial, à travers l’attribution non écrite de la Mairie de Libreville à un ressortissant de l’Estuaire, peut-elle être perçue non comme une entrave à la démocratie locale, mais comme un facteur stabilisateur et un mécanisme de cohésion dans un État marqué par une forte diversité identitaire ?
La gouvernance des collectivités locales dans un État pluri-ethnique comme le Gabon exige une lecture nuancée de la démocratie territoriale, où la représentativité ne se limite pas à la stricte arithmétique électorale, mais s’inscrit dans une logique plus large d’harmonie sociale, de reconnaissance identitaire et de stabilité politique. Le cas particulier de la commune de Libreville, capitale nationale et centre névralgique de notre pays, illustre cette tension entre démocratie formelle et nécessité d’équilibre socio-politique.La tradition politique selon laquelle la gestion de la Mairie de Libreville reviendrait à un ressortissant de l’Estuaire, plus précisément aux communautés autochtones telles que les Mpongwe ou les Fang de cette province, trouve ses racines dans des considérations historiques, sociologiques et géopolitiques que la science politique ne peut ignorer.
LES FONDEMENTS HISTORIQUES ET SOCIOPOLITIQUES DE LA PRATIQUE
Libreville, ville fondée au XIXe siècle sur les terres des Mpongwe, constitue un territoire historiquement ancré dans les dynamiques identitaires de l’Estuaire. Bien que devenue cosmopolite, elle demeure le symbole vivant de l’autochtonie dans un pays où les rapports entre populations locales et "allochtones" restent sensibles. Le fait de confier la direction municipale à un fils ou une fille de l’Estuaire ne relève donc pas d’un communautarisme fermé, mais d’une reconnaissance implicite de cette antériorité territoriale, à laquelle s’ajoute une volonté d’apaisement des tensions communautaires souvent exacerbées dans les contextes électoraux.
Dans une ville qui concentre plus de la moitie de la population nationale et où toutes les provinces sont représentées, la gestion inclusive de l’espace urbain repose sur une forme de légitimité symbolique : confier la Mairie à un représentant local, c’est reconnaître l’histoire, respecter l’équilibre identitaire et éviter les sentiments de dépossession.
UNE LOGIQUE DE STABILITÉ ET DE PRÉVENTION DES CONFLITS
Sur le plan de la gouvernance, cette pratique s’apparente à une forme de pacte social tacite visant à prévenir les conflits latents. Elle repose sur l’idée que certaines fonctions sensibles, comme celle de Maire de la capitale, ne doivent pas être abandonnées à la seule logique majoritaire, mais doivent répondre à une exigence de consensus.
L’attribution de cette fonction à un natif de l’Estuaire est perçue, dans la pratique, comme un acte d’équilibre, évitant de déclencher des ressentiments identitaires qui pourraient miner la paix sociale et la confiance dans les institutions. Cette conception s’inscrit dans la tradition des "équilibres ethno-politiques" observée dans plusieurs États africains postcoloniaux, où la cohabitation pacifique entre les communautés repose sur une répartition non conflictuelle du pouvoir. Loin d’être contraire à la démocratie, cette approche en est plutôt une adaptation contextuelle, tenant compte des réalités sociétales profondes.
La capitale sénégalaise par exemple a été dirigée pendant plusieurs années par Mamadou Diop, membre de l'ethnie Lebou, autochtone de la presqu'île du Cap-Vert où se situe Dakar. Soham El Wardini, originaire de Latmingué dans la région de Kaolack, a été élue maire de Dakar devenant ainsi la première femme à occuper ce poste depuis l'indépendance.
Alfred Oko Vanderpuije, Maire d'Accra de 2009 à 2017, est issu des lignées royales Otublohum et Edina, il incarne l'ancrage local dans la gouvernance de la ville. En mai 2025, Michael Kpakpo Allotey, originaire de North Kaneshie, a été unanimement confirmé comme nouveau Maire d'Accra, illustrant la continuité de la représentation locale.
Adanech Abiebie, élue Maire d'Addis-Abeba en septembre 2021, est originaire de la région d'Oromia. Son élection reflète la reconnaissance des communautés locales dans la gestion de la capitale éthiopienne. Ces quelques exemples démontrent que, dans plusieurs capitales africaines, la gouvernance municipale est souvent confiée à des individus ayant un fort ancrage local.
LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITÉ DANS LA DYNAMIQUE DE L'UNITÉ NATIONALE
Il convient toutefois de préciser que cette coutume n'exclut pas la participation des autres communautés à la gestion municipale. L'élection d'un Maire issu de l’Estuaire s'accompagne toujours, d’une composition inclusive du Bureau du Conseil municipal de Libreville où l’ensemble des sensibilités politiques, ethniques et provinciales est représenté. Cela permet de construire une gouvernance partagée.
Au terme de cette réflexion, il apparaît que la pratique non formalisée attribuant la gestion de la commune de Libreville à un ressortissant de l’Estuaire, qu’il soit Mpongwe ou Fang de la province, loin d’être une aberration démocratique, constitue au contraire un mécanisme subtil de régulation des équilibres socio-politiques dans un État pluri-ethnique tel que le Gabon. Si cette règle est qualifiée de " non écrite ", elle n’en reste pas moins porteuse d’un haut degré de rationalité politique et institutionnelle. Elle répond à une nécessité de stabilité, de représentativité identitaire, et de cohésion sociale, dans une capitale à forte sensibilité symbolique, où coexistent une diversité de groupes culturels, sociaux et économiques.
En effet, dans un État-nation en constante mutation, la démocratie locale ne peut s’envisager dans une stricte perspective arithmétique ou formaliste. Elle doit s’ancrer dans une lecture contextualisée des dynamiques sociales, prenant en compte à la fois l’histoire, la géographie politique, les enjeux identitaires, et les aspirations des populations.
Toutefois, cette pratique, pour être durablement acceptée, gagnerait à s’inscrire dans une approche pédagogique et inclusive. Il ne s’agit pas d’ériger l’ethnie en critère exclusif d’accès au pouvoir local, mais de reconnaître que dans un État où l’ethnicité reste un marqueur sociopolitique important, l'équilibre perçu peut être un facteur de stabilité.
En définitive, cette question soulève un enjeu fondamental : celui de la conciliation entre le droit formel et la légitimité sociale dans la gouvernance locale. Elle appelle à repenser la démocratie non comme un cadre rigide, mais comme un processus dynamique, capable de s’adapter aux exigences de la réalité sociopolitique sans renier ses principes fondateurs. Libreville, capitale plurielle et carrefour des identités gabonaises, mérite une gouvernance qui incarne cette finesse d’équilibre, et qui, dans le respect de l’unité nationale, sache valoriser les ancrages locaux comme piliers de paix et de cohésion durable.
random pub