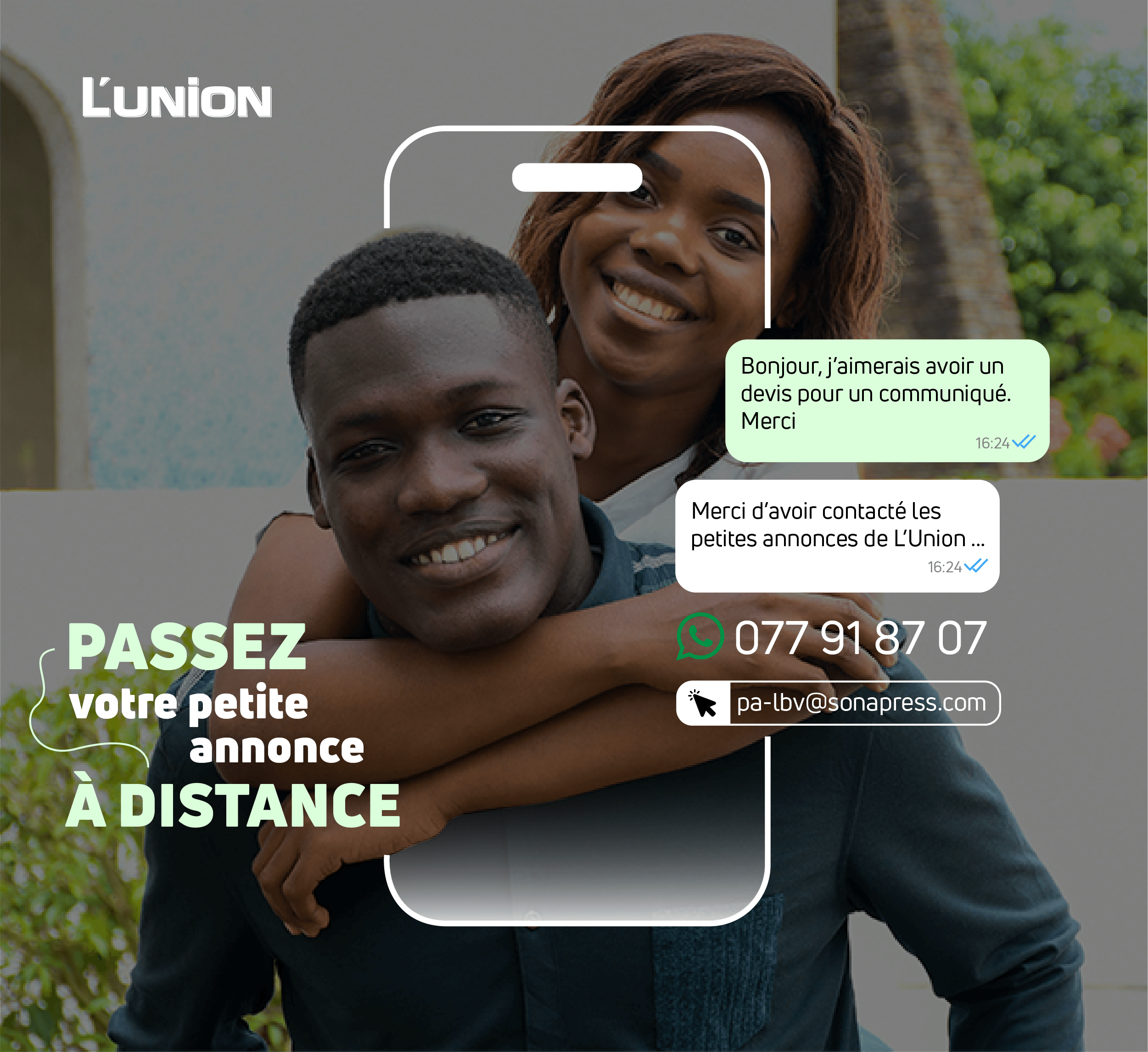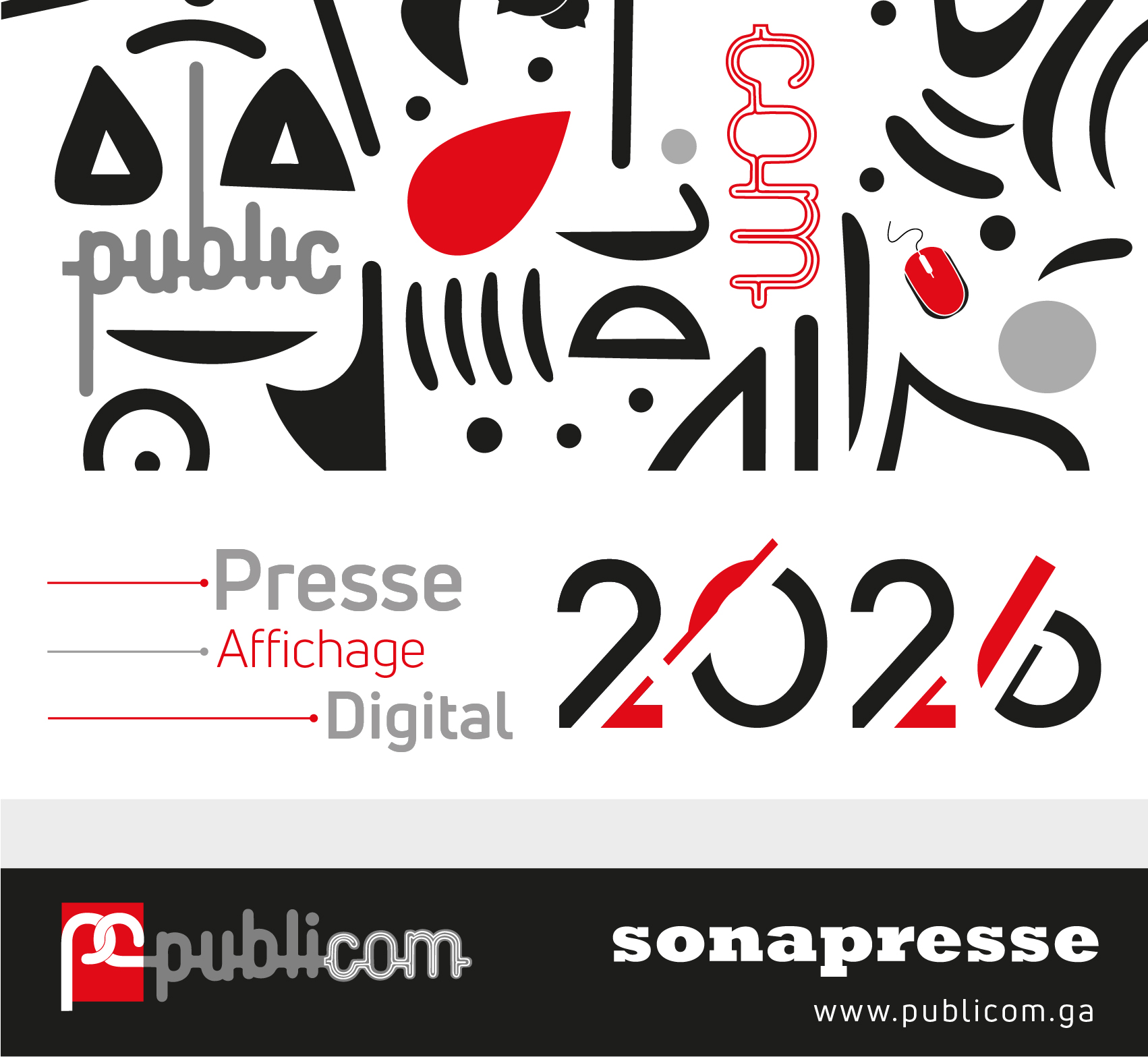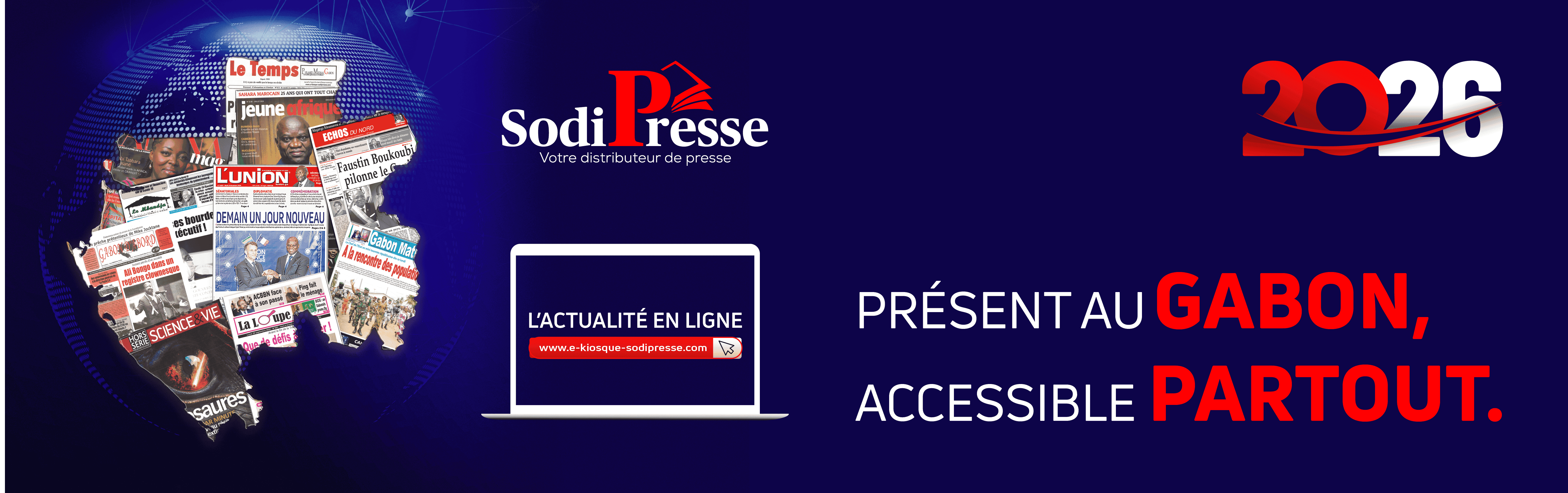Chaque 17 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de l’alimentation. Placée sous le thème "Main dans la main pour une meilleure alimentation et un avenir meilleur", l’édition 2025 met en lumière un paradoxe gabonais : entre abondance apparente et insécurité alimentaire croissante, bien s'alimenter reste un luxe pour beaucoup. À Libreville, les célèbres brochettes d’ailes de poulet ou "nike", qui pullulent le long des rues, sont devenues le repas le plus prisé.
Peu coûteuses et savoureuses, elles séduisent les citadins… pressés. Pourtant, derrière leur succès se cachent des pratiques d’hygiène douteuses : cuisson au bord des routes, viande manipulée à mains nues, poussière et fumée omniprésentes, utilisation excessive des cubes maggi, assaisonnements (mayonnaise et moutarde souvent mal conservées) : cette réalité est banalisée, bien que révélatrice d’un système alimentaire en dérive.
Même constat dans les cafétérias de quartier ou les restaurants improvisés, où les repas rapides remplacent les plats faits maison. La préparation, la conservation et la qualité des aliments échappent souvent à tout contrôle. Dans les foyers, le poulet s’impose comme aliment de base, au détriment du poisson frais devenu trop cher. En effet, entre 3 500 et 5 000 francs CFA le kilo de poisson local, peu de familles peuvent s’offrir une alimentation variée. Même les légumes, pourtant essentiels, sont souvent cultivés avec des engrais chimiques ou pesticides, posant d’autres risques pour la santé.
Cette réalité est aggravée par la flambée continue des prix et l’absence de suivi dans l’application de la nouvelle mercuriale, censée encadrer les tarifs des produits de première nécessité. Dans la pratique, les prix varient d’un marché à l’autre, sans contrôle effectif ni sanction. Les consommateurs se retrouvent seuls face à un coût de la vie qui ne cesse de grimper et de les accabler.
Pendant ce temps, les agences chargées de la sécurité alimentaire, notamment l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (Agasa), s’enlisent dans des crises interminables marquées par des conflits internes. Rivalités administratives, luttes de pouvoir et lenteurs budgétaires paralysent leurs missions de contrôle. Conséquences : les populations ne bénéficient d’aucune protection réelle, tandis que les marchés restent livrés à eux-mêmes.
Cette situation fragilise davantage la confiance du public et accentue les dérives alimentaires déjà visibles. Face à ces défis, les Gabonais mangent certes à leur faim (et là encore !), mais pas toujours sainement. L’alimentation rapide s’impose ainsi comme solution de survie, au détriment de la santé à long terme.
Devant une telle menace de santé publique relative à la malbouffe, une invite s'impose : celle de voir le Gabon repenser la manière de manger de son peuple. Une préoccupation qui passe, entre autres, par les contrôles assidus. Entendu que bien manger ne doit pas être un privilège, mais un droit essentiel pour tous.
random pub